Les faits sont désormais connus de tous. Deux chasseurs ont été condamnés pour être entrés sur une propriété privée et pour les circonstances dans lesquelles un cerf a été achevé. Le tribunal a tranché. Le droit a suivi son cours. Dont acte.
Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée au verdict. Elle a trouvé un prolongement bien plus spectaculaire sur les plateaux de télévision, transformés pour l’occasion en tribunaux moraux. Invité sur BFM TV, Luc Besson n’a pas simplement pris acte de la décision judiciaire. Il l’a jugée presque insuffisante. À l’en croire, ces deux chasseurs auraient mérité la prison. « La taule », selon ses propres mots. Il les qualifie de « criminels », de « barbares », d’« assassins ». Le cerf, lui, pèserait 300 kilos, record biologique inédit, manifestement validé par l’émotion plus que par la science.
Le récit livré est apocalyptique. Onze coups de dague. Une mère âgée terrorisée. Des chiens « non adaptés à la chasse du cerf ». Une seule laisse face à la sauvagerie. Le tableau est si appuyé qu’on en viendrait presque à attendre le générique de fin.
Ce déferlement de morale interroge. Non pas sur le trouble légitime d’une personne confrontée à une scène violente chez elle, que nul ne conteste. Mais sur la posture adoptée ensuite. Celle d’un homme public réclamant l’incarcération de deux chasseurs au nom de l’émotion, transformant un fait cynégétique en affaire quasi criminelle, et distribuant les qualificatifs les plus lourds avec une aisance déconcertante. L’exercice surprend, venant d’un cinéaste dont l’œuvre repose largement sur une mise en scène assumée, répétée et spectaculaire de la violence.
Dans Léon, un tueur à gages solitaire prend sous son aile une enfant de douze ans. Il lui apprend à manier les armes, à viser, à tirer, à tuer. La mort y est méthodique, presque pédagogique, et le spectateur est invité à s’attacher à ce duo improbable où l’apprentissage du meurtre devient un passage initiatique. Dans Nikita, une jeune délinquante est récupérée par l’État, formée, conditionnée, puis envoyée exécuter froidement des cibles humaines. La violence y est propre, silencieuse, institutionnelle. Elle est légitimée par la raison d’État et sublimée par la mise en scène.
Dans Léon encore, un policier cocaïnomane fait irruption dans un appartement et abat parents et enfants sans la moindre hésitation, laissant survivre une enfant traumatisée. La scène est brutale, volontairement choquante, mais elle sert la dramaturgie. Elle est du cinéma. Elle est applaudie. Cette violence-là ne choque pas. Elle est scénarisée, montée, éclairée, rentable. Elle devient art dès lors qu’elle est projetée sur un écran.
Mais lorsqu’elle quitte la fiction, lorsqu’elle n’est plus interprétée par des acteurs, lorsqu’elle concerne des chasseurs et un animal, elle devient soudain insupportable, barbare, criminelle. La violence acceptable serait donc celle qui divertit, pas celle qui dérange. Celle qui rapporte, pas celle qui expose une réalité que certains préfèrent ignorer. Les chasseurs ont été sanctionnés pour l’entrée sur une propriété privée et pour les modalités de l’acte. La justice a statué. Très bien. Mais les ériger en monstres sanguinaires relève moins du droit que du grand spectacle de l’indignation.
Un spectacle auquel Luc Besson se livre avec une ferveur remarquable, oubliant au passage que la nature n’est ni un décor de cinéma ni un conte pour enfants, et que la barbarie ne se définit pas à coups de formules chocs sur les plateaux d’information continue. La justice a parlé. Le reste n’est que du bruit. Et beaucoup de ouin-ouin.

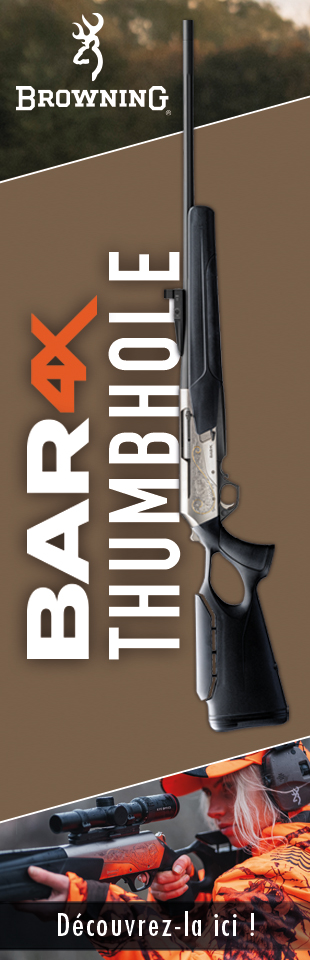










Laisser un commentaire